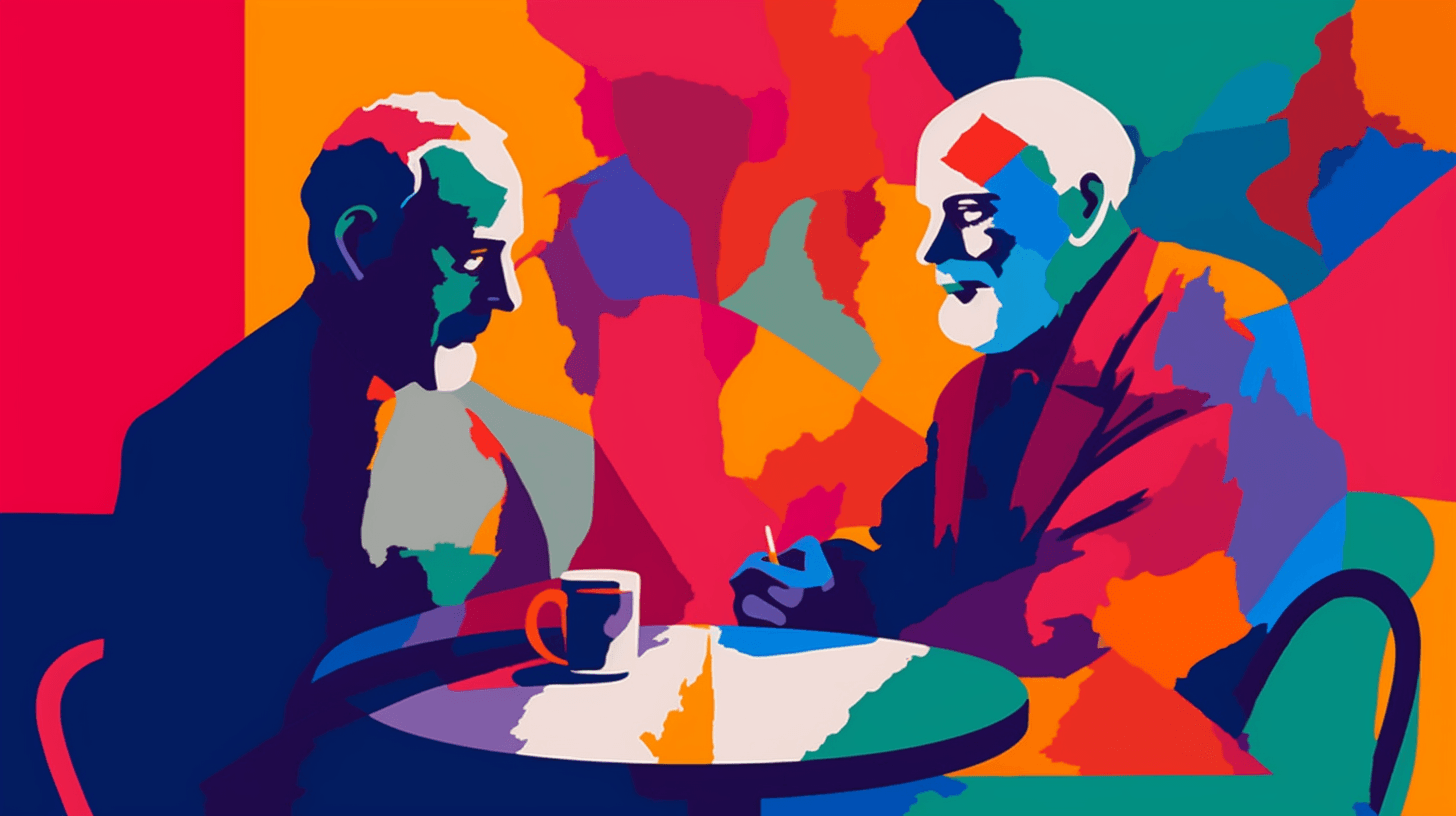Il m’est apparu souhaitable de revenir sur une proposition de Freud conférant à la psychanalyse le statut de « nouvelle discipline scientifique » et d’en développer l’argument jusqu’à ses plus extrêmes conséquences, occasion, somme toute, de tenter de comprendre les raisons d’une obstination qui semble n’avoir suscité que réfutation chez ses détracteurs et incompréhension chez ses adeptes.
À quoi peut bien répondre ce souci de Freud d’affirmer sans cesse combien la psychanalyse est une science, pas une science humaine, une science de la nature, précise-t-il, même s’il lui est impossible d’en préciser le cadre épistémologique ?
On connaît son antienne : la psychanalyse n’est ni une religion (elle ne professe pas une eschatologie) ni une philosophie (elle ne délivre pas une sagesse), mais présente les critères requis pour l’établissement d’une science : elle associe à une région de la réalité, l’inconscient, une procédure d’expérimentation, l’acte analytique, et une exigence de théorisation doublée d’une procédure de validation liée aux effets thérapeutiques de la méthode.
Or, ces critères ont toujours soulevé les plus grandes réserves : l’inconscient déjouerait les règles de l’objectivation et ne serait pas quantifiable, la procédure d’expérimentation ne serait pas reproductible à l’identique et accorderait une place exorbitante à l’observateur, autant de particularités qui vident de leur sens les principes sur lesquels se fondent classiquement les sciences de la nature.
Quand paraît pour la première fois, sous la plume de Freud, le terme de psychanalyse, nous sommes en pleine « querelle des méthodes » opposant depuis longtemps sciences de la nature et sciences de l’esprit, mais qui vient d’être exacerbée par le dernier article de Dilthey paru en 1894, « Idées concernant une psychologie descriptive et analytique », où se trouve le célèbre adage : « Nous expliquons la nature, nous comprenons l’esprit. » Expliquer, erklären, c’est subsumer des phénomènes sous une régularité, quand comprendre, verstehen, c’est prêter à une particularité perçue par introspection un sens qui serait commun à tous.
La thèse de Dilthey n’était point nouvelle. Vingt ans plus tôt, en 1874, Wundt et Brentano avaient publié l’un ses Fondements d’une psychologie physiologique, l’autre sa Psychologie du point de vue empirique, marquant déjà le clivage entre une psychologie naturaliste et une psychologie descriptive se séparant sur l’importance du règne de la « liberté ». Jusqu’où l’homme pouvait-il tirer avantage d’une méthodologie puisée auprès des sciences de la nature, jusqu’où devait-il bénéficier d’un privilège de juridiction lié à sa prétendue place particulière dans l’univers de la création ?
D’une certaine manière, le béhaviorisme de Watson comme le cognitivisme aujourd’hui se sont inscrits à la suite du projet de Wundt quand le courant herméneutique (Husserl, Binswanger, Heidegger, Ricœur, Habermas… ) s’est développé dans la suite de l’enseignement de Brentano.
Or, la particularité de la démarche de Freud est de ne se rattacher à aucun de ces deux courants qui impliquent le même présupposé : on ne pourrait commencer une réflexion psychologique qu’à partir d’une certaine conception de l’homme préalablement donnée d’où découlerait le choix de la méthode utilisée comme les résultats fournis.
Prenons le béhaviorisme ; il s’agit de limiter l’investigation à l’observation des comportements sous le seul rapport du schème stimulusréponse, comme si entre l’input et l’output se trouvait une boîte noire sur laquelle il n’y aurait pas lieu de s’arrêter.
Prenons le cognitivisme ; il s’agit d’insérer entre l’input et l’output des « fonctions mentales supérieures » modelées sur les mécanismes « computationnels » des ordinateurs et susceptibles d’intervenir sur les stimuli assimilés à des éléments d’information.
Prenons l’herméneutique; il s’agit de mettre au jour les possibilités de ce qui est à comprendre de l’homme dont la dimension excède le monde de la rationalité et le constitue comme projet vers un horizon de sens.
Or, rien de tel chez Freud, point de présupposé, et cette tabula rasa est si étonnante qu’on l’a oubliée.
L’hypothèse de l’inconscient comme les règles du protocole ne sont pas sorties toutes armées de la tête de Freud : la première est postérieure à la détermination de la seconde qui elle-même fut le fruit de remarques de patients : la psychanalyse est née d’une situation expérimentale « bricolée ».
Dans l’article suscité de 1896, le terme « inconscient » apparaît sous une forme adjectivale et dans la lettre à Fliess du 6 décembre de la même année, il désigne simplement un des modes d’enregistrement des perceptions. Ce n’est qu’au cours de la rédaction de Die Traumdeutung à l’été 1899 que l’inconscient devient le nom d’une hypothèse heuristique.
Quant au protocole, Freud le met en place bien avant, dès le 12 mai 1889, quand il accepte la requête d’une de ses patientes, Emmy von N., de la laisser parler librement. Puis, à l’automne 1892, avec Élisabeth von R…, réfractaire à l’hypnose, il utilise la technique de « concentration » pour enclencher les associations libres. Enfin, en 1896, il décide d’abandonner l’hypnose et de privilégier la méthode de l’« analyse psychique » dont le ressort est le transfert : la pratique a imposé ses règles.
La découverte de la psychanalyse est ainsi le fruit d’une situation expérimentale dont l’intelligibilité n’a été rendue possible qu’après coup grâce à l’invention de l’hypothèse de l’inconscient qui inclut en elle l’hypothèse tout aussi heuristique de libido psychique formulée dès le manuscrit E en juin 1894.
Mutatis mutandis, se répète le « mystère » de la découverte scientifique. C’est aussi à partir d’expériences « bricolées » que Claude Bernard a trouvé, comme il le racontera lui-même, ce qu’il ne cherchait pas. Contre les principes d’Auguste Comte, il mit au point une technique dont l’intelligence ne devait surgir qu’après coup quand il forgea l’hypothèse du milieu intérieur, nouvelle région de réalité répugnant de surcroît à sa modélisation algébrique, le « vivant » étant qualitatif avant d’être quantitatif. Mais l’intérêt de cette hypothèse dépassait la simple délimitation d’un champ : elle instaurait l’autonomisation des fonctions organiques au regard des mécanismes physico-chimiques et elle dégageait le « vivant » du vitalisme métaphysique.
Le mode de découverte de l’inconscient n’est donc pas si incongru et renvoie, au même titre que le milieu intérieur de Claude Bernard, à une région de réalité spécifique dont les propriétés, comme le précisera très vite Freud, sont distinctes des mécanismes physico-chimiques cérébraux tout en n’étant nullement assimilables à quelque arrière-monde romantique, métaphysique ou religieux.
En un mot, la psychanalyse est à la province de l’esprit ce que la physiologie est à celle du corps, l’une et l’autre étant les disciplines chargées de mettre en évidence les principes réglant le fonctionnement de ces régions de réalité. Or, ces principes sont identiques : l’hypothèse du milieu intérieur et celle de l’inconscient sont d’emblée associées au déterminisme et au principe de constance ou d’entropie.
Là où le béhaviorisme s’emploie à observer les réactions comportementales à des stimuli et à en dresser les moyennes statistiques pour établir des références normatives; là où le cognitivisme s’emploie à façonner des programmes informatiques susceptibles d’évoquer certaines modalités des fonctions mentales, là où l’herméneutique s’emploie à imaginer quel horizon de sens conviendrait à l’existence, Claude Bernard et Freud s’emploient directement dans une expérimentation in vivo.
Mais cette situation n’est pas propre à la physiologie et à la psychanalyse ; elle est commune à toutes les sciences expérimentales : c’est en « bricolant » une expérience pour résoudre le problème du rayonnement du corps noir que Planck se retrouve contraint d’inventer l’hypothèse d’une émission discontinue d’où devait naître la mécanique quantique.
Une hypothèse n’est pas du tout dans la même situation épistémologique qu’un postulat. Le milieu intérieur ou l’inconscient sont des opérateurs expérimentaux. Mais qu’il n’y ait rien à envisager entre l’input et l’output (béhaviorisme), que l’expérience de pensée de Turing soit un modèle satisfaisant pour rendre compte de l’esprit (cognitivisme) ou que l’homme soit l’existant pris par le souci de l’ouverture au sens (herméneutique) sont des présupposés relevant de la seule croyance.
Pour Claude Bernard, il n’y a pas de faits bruts qui se donneraient tels quels à l’observation comme il n’y a pas de « vérités » qui subsisteraient malgré leur infirmation éventuelle par l’expérience : le fait est isolé, dégagé, produit par l’hypothèse qui en assure la construction et dont il est la condition de validation. La théorie est un modèle provisoire d’explication des éléments d’observations comme la répétition des investigations assure ou non la légitimité du contenu de l’hypothèse.
De même, Freud n’a jamais cessé de réviser son modèle à l’aune de l’expérience; il n’est ni du côté de la « cueillette des faits » à la Bacon ni du côté de la fixation dogmatique qu’on trouve dans le béhaviorisme, le cognitivisme ou les disciplines herméneutiques. Il est du côté de cet entre-deux où s’articulent, selon le mot de Claude Bernard, l’idée expérimentale et l’observation et où il faut être « hardi et libre » pour sans cesse accepter le fait qui contredit l’idée et l’idée qui heurte le fait : « Le fait, plus ou moins clairement aperçu, suggère l’idée d’une explication ; cette idée, le savant demande à l’expérience de la confirmer; mais tout le temps que son expérience dure, il doit se tenir prêt à abandonner son hypothèse ou à la remodeler sur les faits. La recherche scientifique est donc un dialogue entre l’esprit et la nature. »
Reste que la « nature » étudiée par Freud n’est pas la fonction glycogénique du foie : le cerveau ne sécrète pas la pensée comme le foie sécrète la bile; c’est une « nature » qui ne se voit pas, ne se mesure pas, est à chaque fois différente dans le contenu de sa manifestation : elle s’entend seulement, sous un rapport à chaque fois singulier, et au cours d’un protocole contraint par des règles qui en empêchent l’accès à ceux qui n’en ont pas la formation qui n’est autre que le protocole lui-même, double condition où se dissolvent objectivité et mesurabilité, reproductibilité et neutralité.
C’est dire le pari de Freud : d’avoir osé déplacer les règles de l’expérimentation pour l’adapter à son objet afin d’accéder à la connaissance des régularités du fonctionnement psychique sans que cet ajustement se révèle dirimant pour l’hypothèse de l’inconscient qui, contrairement aux présupposés du béhaviorisme, du cognitivisme et de l’herméneutique, doit sans cesse tenir compte du caractère éminemment singulier de l’activité psychique de chacun. Si, pour reprendre l’image chère aux cognitivistes, le programme est à l’ordinateur ce que la pensée est au cerveau, il n’en reste pas moins que l’inconscient individualise inévitablement ce programme et lui confère une dimension singulière.
C’est en cela que l’inconscient déjoue les règles de l’objectivation et n’est pas quantifiable ou que la procédure d’expérimentation n’est pas reproductible à l’identique et accorde une place exorbitante à l’observateur.
Or, l’épistémologie contemporaine justifie a posteriori le coup de force de Freud en mettant en cause la légitimité des principes qui gouvernent les sciences classiques de la nature.
L’objectivité et la mesurabilité de l’objet, la reproductibilité de l’expérience et la neutralité de l’observateur renvoient à une certaine conception de la science plus idéale que réelle, de surcroît entamée par la mécanique statistique et surtout par la mécanique quantique : tout système quantique ne subit-il pas au cours d’une observation une perturbation imprévisible et incontrôlable qui limite irréductiblement la connaissance possible des caractéristiques du système ?
Certes, il s’agit là d’interaction entre un rayonnement et un instrument de mesure (un compteur Geiger par exemple) et non d’interaction entre deux « subjectivités », à ceci près que ces dites « subjectivités » ne sont pas immatérielles : la réalité psychique n’a pas le statut d’une entité spirituelle incorporelle, au point que la situation analytique est directement un champ au sens où ce terme s’emploie en électromagnétique ou en mécanique quantique : c’est une situation mobilisant les équivalents « énergétiques » que sont le transfert de l’analysant et le contre-transfert de l’analyste, sans que ni l’un ni l’autre ne puissent se dérober à cette interaction.
Quant à prétendre décrire la réalité elle-même, aucune science ne s’avance aujourd’hui sur ce terrain, sachant qu’à chaque fois, elle ne rend compte que d’une région de réalité à un moment donné et sous le rapport de ses conditions d’observation. La mécanique galiléenne butait déjà sur cette indétermination dès qu’on quittait sa modélisation pour une application effective : il y avait le frottement. Un écart invincible subsiste entre théorie et réalité et oblige à penser leur articulation à partir d’une prédictibilité probabiliste qui, si elle est délicate à concevoir dans le cas de la psychanalyse, n’est pas pour autant impossible à penser pour peu que soient repérés les éléments constitutifs de la réalité psychique de l’analysant qui ne sont jamais si éloignés que cela de modalités connues.
Cette relativisation des principes gouvernant les sciences classiques de la nature est interne à leur histoire et n’en est pas séparable. Le « développement » scientifique est une suite de crises et de révolutions. Combien de temps a-t-il fallu pour que la théorie phlogistique fût abandonnée et que naquît la chimie moderne, elle-même remaniée de part en part par la mécanique quantique ?
Depuis les travaux de Bachelard et de Kuhn, on a pris la mesure des obstacles « psychologiques » qui empêchent d’envisager la nouveauté et retardent le changement du modèle théorique de référence malgré son incapacité à répondre aux observations qui le contredisent : nous renâclons aux mutations et trouvons toujours plus clair ce dont nous avons l’habitude.
Il n’est donc pas surprenant de noter que les courants de pensée qui s’obstinent le plus à récuser la scientificité de la psychanalyse, béhaviorisme, cognitivisme, herméneutique, se rattachent à des paradigmes qui lui sont antérieurs.
Le cognitivisme est fondé sur un paralogisme assimilant les fonctions dites de l’esprit (perception, attention, etc.) à des propriétés neurologiques en réseaux (théorie du connexionnisme) ou en articulation computationnelle répondant au célèbre adage : thinking is reckoning, penser, c’est calculer.
Héritier du parallélisme psychophysique qui fut le paradigme dominant du XIXe siècle, il fut mis « à la mode » par le programme de naturalisation de Quine et surtout par l’expérience de pensée de Turing appelée aussi « machine de Turing » qui au départ était destinée à résoudre un problème de logique à l’aide d’un artifice utilisé par Gödel : on peut coder des formules et aboutir ainsi à une arithmétisation de la logique : penser, c’est alors calculer. On connaît, avec les ordinateurs, la suite qui fut donnée à cette expérience de pensée, mais on sait moins que c’est pour résoudre un problème de défense aérienne que Wiener en 1943 en utilisa le principe : il s’agissait d’un automate susceptible de modifier sa réponse à un stimulus pour atteindre un objectif donné : au modèle béhavioriste était surajouté entre l’input et l’output un « programme » régulateur; il suffisait d’extrapoler à l’esprit humain et le cognitivisme était né, ce que le neurophysiologiste Mc Culloch se dépêcha de faire.
Si cette « nouvelle » discipline a connu un développement considérable, elle demeure néanmoins fondée sur son paralogisme de départ qui la situe, malgré tout, plus du côté des sciences formelles que des sciences expérimentales : le modèle cognitiviste est une construction idéale qui ne fait référence qu’à certaines fonctions mentales (perceptions, etc.), sans tenir compte de l’esprit réel toujours déjà corrodé par le symptôme, l’acte manqué, le lapsus, la répétition, c’est-à-dire tout ce qui constitue la singularité effective de chacun.
Cet aspect formel du cognitivisme n’est pas seulement lié à ses origines (la « machine de Turing ») ou à l’idéalité de son modèle, il est aussi induit par sa conception du rapport du sujet au monde qui n’est plus médiatisé par le phénomène, c’est-à-dire par une construction psychique, mais est directement articulé aux choses. Le cognitivisme serait ainsi une extension du programme de l’empirisme logique comme le montre l’évolution de ses recherches vers les problèmes de la perception et des interactions entre l’organisme et son environnement sur le mode du traitement de l’information.
Cette naturalisation du contenu des états mentaux n’est bien sûr pas en cause, Freud y souscrit sans réserve, c’est l’évacuation simultanée et subreptice de la représentation comme construction singulière qui fait problème.
De plus, comme l’a souligné encore récemment Kim , comment imaginer l’action des éléments de l’esprit sur le corps ? Il ne suffit pas d’affirmer que les propriétés mentales sont implémentées, c’est-à-dire articulées, dans des structures physiques, pour qu’elles aient un rôle causal. Bref, les cognitivistes ne sont-ils pas, comme Descartes, enfermés dans l’épiphénoménisme ?
Quoi qu’il en soit, on peut se demander à quel titre une science aussi formelle que le cognitivisme s’érige en juge d’une science expérimentale ou de quel droit le cognitivisme fait la leçon à la psychanalyse ?
Un mot maintenant sur le béhaviorisme que l’histoire des idées a déjà remisé au magasin des modes passées. Et pourtant, si une discipline psychologique pouvait revendiquer le statut de science expérimentale, c’était bien elle. Elle avait su se donner un protocole précis et cohérent, mais entravé dans l’intelligence de son objet par un présupposé observationnel limitant considérablement ses investigations. En se refusant à envisager qu’entre le stimulus et la réponse, il puisse y avoir quelque chose, cela donnait de l’expérience humaine une vision simplifiée, sauf à se servir de cette compression pour l’édifier en norme comportementale à des fins politiques, comme s’y employa Skinner.
Là encore, on peut s’interroger sur la prétention d’une science, certes expérimentale, mais grevée de préjugés méthodologiques et même socio-politiques, à jauger la scientificité de la psychanalyse.
Quant à l’herméneutique, elle poursuit la réhabilitation d’une méthodologie prétendument spécifique aux sciences de l’esprit fondée sur la compréhension de l’expérience vécue, l’Erlebnis. Ce courant, dont la postérité est liée à son soubassement religieux et métaphysique, est associé aujourd’hui aux noms de Ricœur et Habermas qui n’ont de cesse d’appeler les analystes à les rejoindre et à renier le naturalisme de Freud.
Mais si on comprend que l’herméneutique répugne au naturalisme de Freud, on est surpris de constater à quel point cognitivistes et béhavioristes n’arrivent pas à concevoir qu’il en est bien ainsi, que la psychanalyse est un naturalisme, et même que Freud a réalisé ce qu’ils ne pouvaient imaginer réussir dans leurs rêves les plus audacieux en expérimentant in vivo.
Ce physicalisme radical de Freud répond ainsi par avance aux objections de Kim rappelées plus haut : les processus inconscients ont bien un rôle causal tout simplement parce qu’ils sont matériels (ainsi des pulsions chez Freud ou du signifiant chez Lacan).
L’enjeu entre cognitivisme, béhaviorisme, herméneutique et psychanalyse est celui de la singularité et donc de la liberté : l’hypothèse de l’inconscient est une théorie de la matérialité de la réalité psychique comme de sa singularité.
Cette liberté n’est point liberté d’être autre, mais liberté de faire avec les formations de l’inconscient que sont nos symptômes, nos inhibitions et nos angoisses.
Le refus du nouveau paradigme que constitue la psychanalyse est sûrement à mettre au compte de cette mise en relief de la singularité à laquelle aucun des trois courants de la psychologie académique ne peut se résoudre ; et cette opposition est d’autant plus troublante qu’il s’agit sûrement du premier véritable paradigme expérimental au sein des sciences psychologiques comme le montrent les conditions de sa découverte. Mais comment admettre une science du singulier ?
Si les travaux de Kuhn permettent de rappeler les difficultés inhérentes à tout changement de paradigme, ceux de Duhem et Fraassen autorisent à envisager le bien-fondé de la position de Freud d’avoir modifié le cadre de l’expérimentation pour le faire coïncider avec les particularités de son objet.
L’hypothèse de l’inconscient répond à une donnée empirique et à ce titre fonctionne comme « théorie empiriquement adéquate
» dont la légitimité ne peut être invalidée par une ou même plusieurs épreuves, mais seulement appréciée sur la continuité et la multiplication des opérations, tout simplement parce qu’« il n’y a jamais adéquation complète » entre les faits et la théorie et qu’on « ne peut jamais soumettre au contrôle de l’expérience une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble d’hypothèses».
Le refus de la scientificité de la psychanalyse est ainsi inséparable de l’histoire des sciences : un siècle après la rédaction du De revolutionibus de Copernic, ses thèses sont encore condamnées à l’occasion du procès de Galilée ; quant à la réticence à accepter le paradigme de la psychanalyse, elle est liée à son attention à la singularité qui est contraire aux principes généraux des sciences classiques de la nature.
Mais l’épistémologie ne peut en rester là. Nous ne pouvons plus faire l’impasse sur l’intime, plus précisément l’extime, selon ce mot de Lacan mettant l’accent sur ce qui est le plus au cœur de la « psyché » et qui en même temps en organise l’excentration. De cet intime, le savoir n’est pourtant pas nouveau ; l’homme a toujours su qu’il n’était pas maître chez lui; larvatus prodeo, peut s’écrier Descartes au seuil de son cheminement intellectuel qui le conduira pourtant à affirmer la transparence de la conscience à elle-même. Ce qui est nouveau, c’est de proposer une connaissance expérimentale de cet intime.
Car cet intime n’est point caché, l’inconscient n’est pas inconscient, subtilité qu’a du mal à saisir le cognitivisme qui revendique de disposer lui aussi d’un inconscient et d’un vrai; sauf que son inconscient concerne les processus physico-chimiques neurologiques. Pourquoi ne pas alors parler d’un inconscient du foie ou de la rate : tant que les organes fonctionnent, ils sont silencieux.
L’hypothèse freudienne de l’inconscient a justement ceci de particulier qu’elle renvoie à une réalité absolument consciente, mais dont on ne veut rien savoir. Rêves, rêveries, lapsus, actes manqués, oublis… se présentent à ciel ouvert et sont le lot de tous, y compris de Descartes reconnaissant son faible pour quelque regard « louche ». Si cet intime est extime, c’est qu’il est toujours déjà articulé à l’altérité, à l’Autre : on ne peut penser l’homme sans penser simultanément son rapport à l’Autre : « L’homme est par nature un animal politique. »
Au-delà de leurs divergences sur leurs présupposés, praticiens de l’herméneutique, du béhaviorisme et du cognitivisme se retrouvent sur le rejet de cette intimité singulière toujours déjà articulée à l’altérité qui les heurte par sa prévalence et son irréductibilité disconvenant à l’idée d’harmonie et de maîtrise qui définissait d’une certaine manière jusque-là le paradigme scientifique.
Nous ne pouvons plus aujourd’hui mettre de côté cet intime dont on ne veut rien savoir, comme s’il était accessoire, secondaire, quand nous savons qu’il conditionne le rapport de chacun au monde.
C’est ainsi que la seule lecture aujourd’hui des propositions de Freud, loin du contexte polémique qui entourait l’épistémologie au début du XXe siècle, permet d’apercevoir combien la psychanalyse est sûrement une science, et une science de la nature, dont les principes certes ne sont plus ceux de la physique de Galilée et de Newton, mais qui sont ceux qu’elle partage avec les sciences de notre temps pour peu que soit acceptée la particularité de son objet : prendre en compte l’intime, c’est se retrouver confronté à sa propre intimité. On mesure là toute la difficulté de la découverte freudienne et le courage inouï de son initiateur. Alan Turing, le « père » du cognitivisme, s’est bien gardé de cette confrontation à laquelle néanmoins il n’a pu se dérober, mais dans l’horreur.