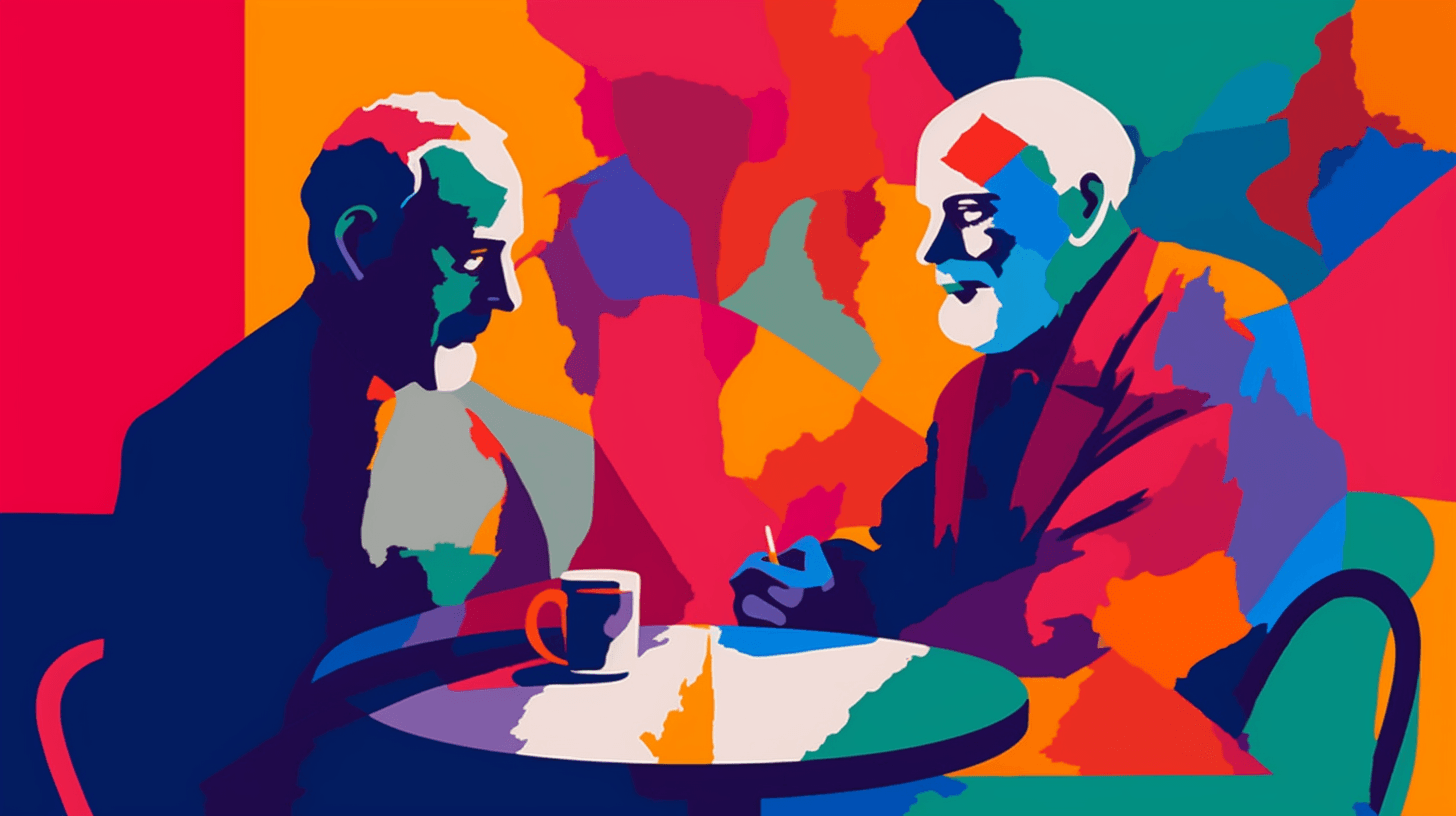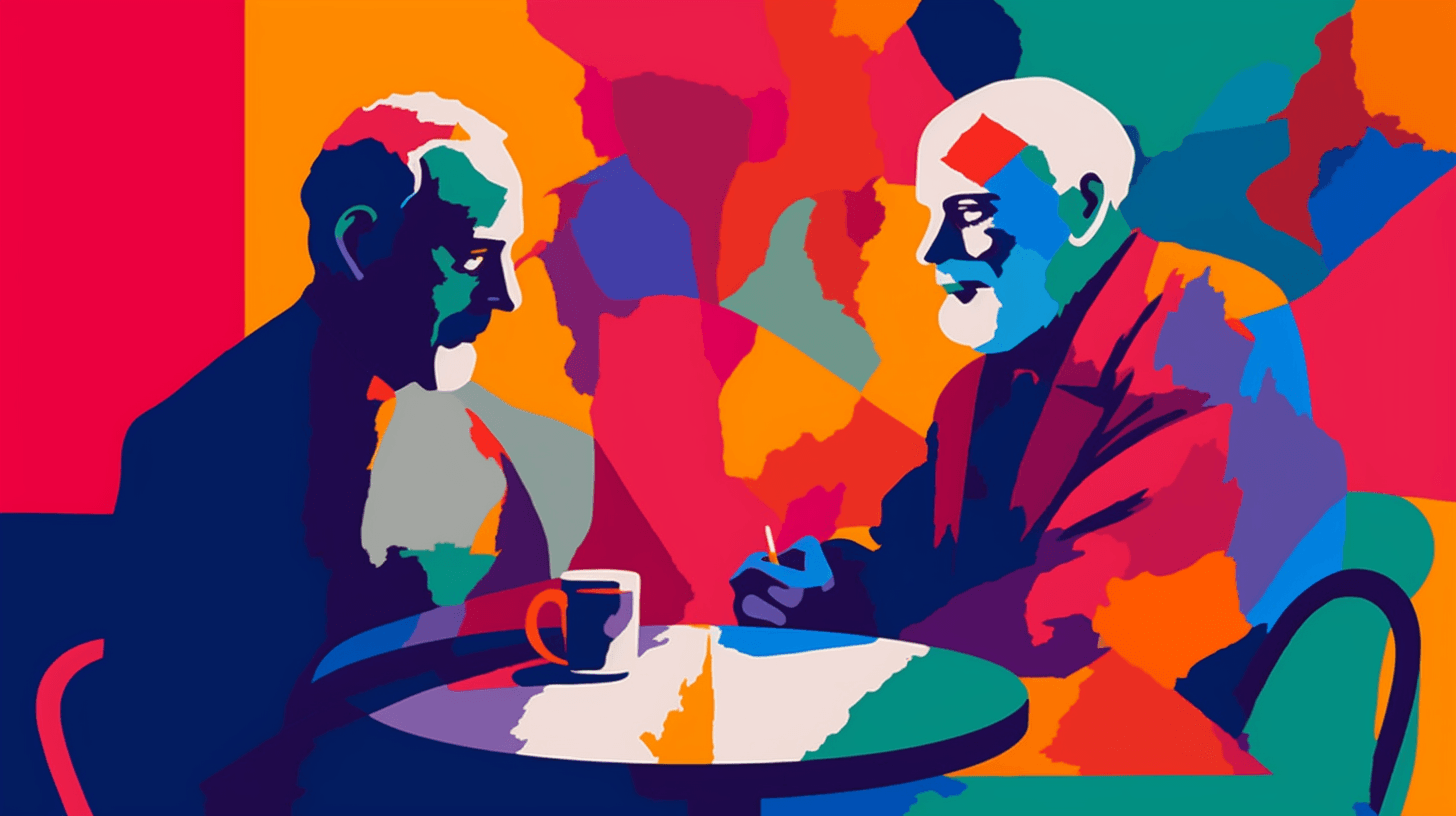
La récente présidence des États-Unis d’Amérique incarnée par Donald Trump pose de nouveau la question de la légitimité de cette organisation du pouvoir résultant de l’élection d’un seul (ou de quelques-uns) par la décision supposée réfléchie de tous engendrant, dans l’instant de leur acte, leur soumission consentie, selon la formule de Hobbes, et qu’on appelle : la démocratie.
Le plus troublant de cette présidence, si l’on y réfléchit, ne fut toutefois pas tant les décisions ubuesques qui y furent prises que la manière dont elles furent prises puisque leur agent, le dénommé Donald Trump, les exprimait à l’occasion de vociférations outrecuidantes mêlant boniments et affabulations, nous évoquant des personnages historiques d’un passé guère éloigné qui avaient pu provoquer par leur démesure des catastrophes, au point de se dire : comment cela est possible ? Comment le président des États-Unis d’Amérique, la Rome moderne, peut sans vergogne et sans que nul le fasse taire ou le destitue se répandre ainsi dans une jouissance – car il s’agissait bien de cela – sans limite ?
Brusquement se posaient à nous deux questions sur lesquelles nous détournons facilement les yeux, comme si chaque fois qu’elles surgissaient nous étions honteux d’y être confrontés de nouveau car elles viennent nous rappeler comment nous sommes, de fait, constitués : Qu’est-ce que la démocratie, du moins ce régime politique appelée ainsi depuis la fin du xviiie siècle ? D’où vient la jouissance lorsqu’elle prend ce visage du mal ?
Son premier observateur, Tocqueville, y a vu un processus inéluctable qu’il associait à juste titre à la mise en place, sans qu’il puisse en préciser la raison, à « l’égalité des conditions » allant de pair avec la disparition de la liberté dont la conséquence était une société de monades posées les unes à part des autres et appelant de leur vœu avec délice un pouvoir tyrannique. Nous sommes loin de la démocratie antique, cette « Cité gonflée d’humeurs » dont Platon se méfiait. Mais, que s’est-il passé de la Cité antique à l’État moderne ? Justement cet idéal de « l’égalité des conditions » vers lequel marcherait l’humanité pour faire triompher ce qu’on appelle, à la suite de Francisco de Vitoria et de l’École de Salamanque, les droits de l’homme accordant à chacun la capacité d’apercevoir le bien de la collectivité que, par quelque clairvoyance ou harmonie spontanée, la majorité montrerait à tous sous le chef de la volonté générale, version rousseauiste de l’adage : vox populi vox Dei.
Donc pendant longtemps on a su et on tenait compte de ce savoir comme l’illustre Machiavel qui espère conjurer ce risque de la folie en imaginant une heureuse astuce.
Pour comprendre celle-ci, rappelons que Machiavel distingue dans les Discorsi le régime de la principauté de celui de la république et qu’il fait l’apologie du premier aux dépens du second. Mais, pourquoi ? Machiavel, ne l’oublions pas, a été le secrétaire du Consiglio Maggiore, du Grand Conseil, et il y a vu à l’œuvre l’influence cachée qu’y exerçait Savonarole : « Qu’ajoute, écrit-il, la participation du peuple au gouvernement si le pouvoir revient encore à un seul par le simple effet de sa rhétorique et ainsi de son charisme
Pour Machiavel, la démocratie peut s’entendre sous deux rapports : celui de la république où elle prend ses conditions auprès de la seule rhétorique et elle n’est alors qu’une fiction au service de ceux qui en ont obtenu la potestas, le pouvoir ; celui de la principauté où elle prend ses conditions auprès de l’ascendant d’un seul et elle repose alors sur l’autorità, l’autorité, de celui-ci.
Mais, qu’est l’autorità, l’autorité ? Machiavel la définit en creux en montrant ce qui suit de l’élimination dans l’État, stato, du site de l’autorità, l’autorité : un mode du penser spécifique qui intéresse le psychanalyste car il y est confronté dans sa pratique. Il s’agit d’un mode du penser où, à l’inverse de la proposition kantienne, il n’y a ni de traitement de la personne comme fin, mais comme moyen. À défaut, comme l’illustrent nos démocraties modernes, le mode du penser pervers trouverait un milieu propice à son déploiement. Il y aurait ainsi une relation conséquente entre le mode du penser pervers et le développement de l’organisation politique devenu prédominante aujourd’hui : la démocratie, pour peu que soit éliminé de l’État le site de l’autorité.
Qu’est-ce que la jouissance du mal ?
Au fil des années de ma pratique de psychanalyste, cette interrogation s’est imposée à partir de mon expérience clinique. Car, c’est ainsi, un psychanalyste reçoit des demandes d’analysants que la justice appelle des criminels par habitude ou consuétudinaires, criminalité sexuelle, criminalité de chef d’entreprise, dite à « col blanc », White Collar, pour reprendre la dénomination de Sutherland), apparaissent aussi l’éducateur abuseur, le businessman véreux et le politicien corrompu.
Que veux-je dire par perversion ?
Si le concept de perversion recouvre depuis trois siècles l’acception médicale de dévoiement d’une fonction physiologique (la perversion des humeurs de Quesnay) et, depuis Magnan (1885) et Krafft-Ebing (1886), celle de la « fonction sexuelle est une invention de Burdach en 1826… », il est à entendre ici dans l’acception que propose Augustin de corruption morale centrée sur la visée de mettre à mal autrui, précise le latin crudelis, employé par Cicéron, pour dire : jouir de mettre à mal autrui, y compris jusqu’à son état de cadavre, et la notion jus naturaliste de « manquement grave à la loi » évoquée par Locke distinguée de la motivation par le gain ou la passion, il lie l’un à l’autre le penser pervers et le crime par habitude et renvoie aux agents qui s’emploient à mal agir dans la visée de mettre à mal autrui du simple fait du mode de leur penser.
Mettre à mal autrui constitue, en sus des crimes motivés par la haine (raptus mélancolique, paranoïaque, obsessionnel, etc., der Gedanke, dont il n’est pas l’équivalent puisqu’il met l’accent sur l’action de penser et non sur le résultat ou son contenu. J’en propose donc le rétablissement.
Cet usage a eu récemment un certain succès grâce à son emploi par Heidegger lorsqu’il égale sa fonction à la capacité du Dasein de s’ouvrir à l’Être à la différence de sa déchéance par la « pensée calculante » ou la dictature du « On » « Penser, écrit-il, c’est « 1) penser par soi-même ; 2) penser en se mettant à la place de tout autre ; 3) toujours penser en accord avec soi-même.
Cette manière d’appréhender le penser me paraît proche de mon expérience clinique où je fais le constat qu’il n’est pas donné à tous d’exercer ainsi le penser, c’est-à-dire de penser en tenant compte d’autrui tout en ayant la capacité de modifier son point de vue, voire d’avoir une vision synoptique, Übersicht, pour reprendre la suggestion de Wittgenstein, ou de voir la situation dans sa totalité, pour reprendre celle d’Austin (1958), dans Cahiers de….
Ainsi, nombre d’analysants présentent un penser solipsiste, partiel chez le névrosé, plus continu chez le pervers et le psychotique. « La réflexion, écrit justement Blumenberg, n’appartient pas nécessairement à la conscience Dans le roman de Fiodor Dostoïevski, Crime et Châtiment, Raskolnikov pense à Aliona Ivanovna ; incontestablement, il a conscience de la réalité de cette vieille usurière, mais son obnubilation entrave son penser, il ne manifeste aucune réflexion, au point qu’il accomplit son passage à l’acte sans prendre la mesure que son acte lui sera insupportable et qu’il sera rongé par la culpabilité le restant de ses jours.
On sait qu’une des grandes nouveautés de Frege est d’avoir montré que le penser varie d’un sujet à l’autre par les manifestations de la subjectivité singulière de celui qui a à penser, ce qu’il appelle la « coloration du penser » qui vient altérer peu ou prou la saisie, fassen, du sens partagé par la communauté, Sinn. C’est le propos de La Dialectique de la raison de Horkheimer et Adorno dont le fil conducteur est l’exposé des avanies du penser sous les effets du nazisme ou de l’attitude des personnages de Sade
Tout analysant, au début de sa cure, a le penser obnubilé par son objet, qu’il s’agisse du penser de l’hystérique, ainsi Emma Bovary saisie par les enjeux de sa reconnaissance immédiate où Rodolphe et Léon ne sont que de simples surfaces sur lesquelles elle projette sa revendication, ou du penser de l’obsessionnel, ainsi Léon Delmont (La Modification de Butor) arrêté par les enjeux de sa reconnaissance future qui sera, est-il convaincu, à proportion de la réalisation de son devoir, d’où son « choix » de rester auprès de son épouse aux dépens du vécu partagé avec Cécile, sa maîtresse. Puis, au fil de la cure analytique, on assiste au déploiement du penser de l’analysant au fil de la la transformation de son fantasme.
Que veux-je dire par le penser pervers ?
Si le penser de l’hystérique est figé par l’envie de l’objet et celui de l’obsessionnel par la culpabilité inhérente à la soustraction de son devoir, si le penser du paranoïaque est figé par la haine du persécuteur et celui du schizophrène par l’injonction du délire, le penser du pervers est obnubilé par l’obligation du recours à l’acte : il ne pense qu’à ça ; et cette obligation accapare son penser au point que le pervers ne peut penser autre chose ou autrement.
Le pervers ne peut cesser d’avoir recours à l’acte criminel où est agie la mise à mal d’autrui réduit au rang de déchet anonyme ; le recours à l’acte lui est nécessaire comme au névrosé est nécessaire l’expression du fantasme. Le recours à l’acte est l’équivalent de l’expression du fantasme ; le recours à l’acte fait exister le pervers : la scène criminelle lui tient lieu de scène fantasmatique.
Le pervers en est Gedankenlosigkeit, doté d’un penser évidé. Si le mot apparaît sous la plume de Heidegger dans Sein und Zeit et surtout dans Gelassenheit Cette obnubilation n’est pas propre au penser du nazi ou du khmer rouge, elle définit le serial killer, le pédophile assassin, l’entrepreneur véreux, le politicien corrompu, celui dont Maupassant, bien avant Lincoln Steffens et Arnold Heidenheimer, fait le portrait sous les traits de Georges Duroy
Mais, c’est surtout Kant qui ne saisit absolument pas l’importance des figures traditionnelles de l’autorité puisqu’il s’en remet à la constitution du transcendantal en affirmant que le droit de l’homme naturel, natürliche Recht, et le droit positif, öffentliche Recht, sont sous la dépendance de l’idée de droit naturel, Naturrecht. Pour Kant, l’autorité n’a nullement besoin de reposer sur une personne du monde, quelles qu’en soient les qualités sublimes, puisque nous serions dotés d’une idée de la raison fournissant à chacun une sphère de normativité juridique a priori.
En somme, le pire des scélérats ne serait pas sans connaître l’idée du juste quand bien même ne la prend-il pas comme maxime de son action. Mais, s’il ne la prend pas pour maxime de son action, c’est qu’il y a un défaut du transcendantal. Or, la constitution du transcendantal repose sur des contraintes environnementales (épigenèse) variables d’un sujet l’autre, ce qui rend souhaitable le maintien des figures traditionnelles de l’autorité qui, en cas de défaut du transcendantal, viennent faire signe vers lui, vers cette idée du juste, permettant d’en pallier le déficit.
C’est justement ce que ne comprend pas Kant. Or, son importance dans l’institution du politique depuis la fin du xviiie siècle est immense : on réclame partout l’avènement des droits de l’homme comme l’abolition des figures de l’autorité.
Mais, la nécessité de relayer le transcendantal par des figures de l’autorité fut, et l’est encore, méconnue comme l’illustrent la théorie pure du droit de Hans Kelsen, la théorie de la justice de John Rawls ou les œuvres de Jürgen Habermas et de Karl Apel. Seuls Freud puis Lacan s’y sont confronté.
Comment Freud puis Lacan montrent la nécessité de l’autorité ?
Machiavel, disions-nous, avait déjà saisi la nécessité de l’autorité pour atténuer les conséquences du défaut de l’idée du juste comme régulatrice de la raison : « Si les hommes, écrit Claude Lefort citant les Discorsi, ne font le bien que forcément puisque dès qu’ils ont la liberté de commettre le mal avec impunité, ils ne manquent de porter partout la turbulence et le désordre, il suit que c’est dans l’espace de la société politique qu’il convient d’interroger l’origine de la loi
Si je cite Claude Lefort citant Machiavel, c’est que c’est à partir de Freud et de Lacan que le lecteur de Machiavel que fut Claude Lefort lit l’auteur du Prince – Lefort assiste au séminaire de Lacan de 1964 à 1966 et Lacan assiste à sa soutenance de thèse sur Machiavel.
Et c’est justement ce point d’appui à partir duquel il lit Machiavel qui autorise Lefort à opérer une distinction entre le politique et la politique, entre ce qui renvoie à l’autorité (et donc, à travers ses figures, au transcendantal) et ce qui renvoie au pouvoir mais sans les confondre, comme s’y emploie à l’inverse Carl Schmitt en assimilant l’autorité au monopole de la décision.
Ce n’est donc pas la raison qui d’elle-même est l’agent de la moralité, explique Freud à Kelsen, ce sont les règles familiales et sociales qui le sont précise-t-il en 1932 : « L’institution du surmoi, écrit-il, peut être décrite comme un cas réussi d’identification avec l’instance parentale [Il] est ce qui représente pour nous toutes les limitations morales, l’avocat de l’aspiration au perfectionnement… [Il] ne s’édifie pas d’après le modèle des parents mais d’après le surmoi des parents ; il se remplit du même contenu, il devient porteur de la tradition, de toutes les valeurs à l’épreuve du temps qui se sont perpétuées de cette manière de génération en génération,…. »
Enfin, en 1938, Freud publie L’Homme Moïse où il revient sur la fonction, entraperçue par Rousseau, du Législateur supposé mais « refoulé » dont l’effectivité se mesure à l’implémentation réussie ou non du transcendantal et donc du site de l’autorité enlevant ou non toute nécessité à la figuration de cette dernière, de sorte qu’il y aurait ceux qui n’accèdent pas au transcendantal et qui ont absolument besoin d’une figure d’autorité, ils en restent à la partie gauche des formules de la sexuation de Lacan, et il y aurait ceux qui accèdent peu ou prou au transcendantal et qui n’ont nul besoin d’une figure d’autorité sauf au titre de semblant, ils parviennent à la partie droite, celle où l’idée de la raison suffit à assurer la maxime de leur volonté sans la moindre considération pour la fin de l’action envisagée et sans s’arrêter sur les motifs de l’action : le bien n’est pas le juste et seul le juste importe ici.
La place manque de développer un point qui échappe au lecteur pressé du Moïse : c’est l’emploi par Freud du concept d’arrière-plan, Hintergrund, qui spécifie combien les règles s’imposent à chacun quand bien même nous n’en aurions aucun souvenir, c’est-à-dire combien la détermination du juste, ce qui est moral de faire, s’impose de lui-même… si l’implémentation en a été faite.
Si ce n’est donc pas un hasard si notre temps est celui des regrets de l’autorité – pas un jour sans un concert de lamentations – ce temps est aussi celui de l’impossibilité de penser l’autorité, nous ne savons plus ce que ce mot veut dire, de sorte qu’en effaçant la nécessité de l’autorité, dans le droit fil de la révolution nominaliste du xive siècle, Kant expose le cadre qui rend possible Sade comme l’explique Lacan dans Kant avec Sade : « La Philosophie dans le boudoir, écrit Lacan, vient huit ans après la Critique de la raison pratique. Si, après avoir vu qu’elle s’y accorde, nous démontrons qu’elle la complète, nous dirons qu’elle donne la vérité de la Critique, au point, poursuit Lacan, que la maxime de l’impératif catégorique peut s’entendre tout aussi bien sous la forme où l’Autre m’affirme : « J’ai le droit de jouir de ton corps et ce droit je l’exercerai sans qu’aucune limite m’arrête dans le caprice des exactions que j’ai le goût d’y assouvir
On comprend que l’autorité soit une question qui hante Freud et Lacan, et, pour ce dernier, dès l’élaboration de la notion du déclin de l’imago paternelle de l’article des Complexes familiaux de 1938 qui doit certes à l’ouvrage de Horkheimer Studien über Autorität und Familie paru en 1936 mais où ce dernier témoigne de sa méconnaissance de la question de l’autorité.
Bien sûr, certains auteurs se sont attelés à la définir, mais avec quel résultat ? Le moins que l’on puisse dire, c’est – je pense à Max Weber, disons plutôt le politique.
Alors, le crime consuétudinaire, une conséquence de la démocratie ?
Depuis l’avènement de la démocratie aux États-Unis puis en Europe à la fin du xviiie siècle, il y a eu une explosion de cette criminalité doublée de l’extraordinaire fascination qu’elle exerce, comme en témoigne Thomas de Quincey et son De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts, comme si le criminel osait là où l’homme ordinaire restait « prisonnier » de la morale partagée, c’est-à-dire comme si le criminel venait revêtir pour l’homme ordinaire le visage de ce père originaire de Totem et tabou se livrant à tous les excès.
Si cette criminalité évoque avant tout les serial killers devenus un phénomène ordinaire, ceux-ci n’en constituent qu’une faible partie au regard des abus sexuels sur mineurs, des violences aux personnes, de la délinquance en « col blanc » et de la corruption politique.
Certes, il y a toujours eu des abus sexuels sur mineurs et des violences aux personnes, mais la criminalité consuétudinaire y ajoute le souci prioritaire de mettre à mal autrui, et si les viols sur enfants, multipliés par six entre 1825 et 1855, et les violences sur adultes, multipliées par deux dans le même délai de l’hôpital général, mais ces jeunes filles étaient ensuite dotées et mariées, de sorte qu’on est à mille lieues des sévices sexuels à l’exemple de ceux que Sade impose à la veuve Keller ou de ceux qui seront imposés à des enfants en très bas âge à partir du xixe siècle. Il y a un monde entre les parties fines de Louis XV au Parc-aux-Cerfs et les abominations d’un Marc Dutroux.
On assiste donc à un changement dans l’acte criminel puis secondairement à une transformation du regard du public
Or, justement, cette question de l’intention du criminel est centrale, en particulier dans le cas du White collar crime, mais qu’on refuse de voir, au point qu’il y a un monde entre les crimes White collar, leurs procédures judiciaires, quand il y en a, et les sanctions qui s’ensuivent, lorsqu’il y en a ; un courant d’opinion prône même leur dépénalisation.
Si le concept de White collar crime est proposé par Sutherland en 1939, il n’a pas attendu cette célèbre allocution devant la Société américaine de sociologie pour exister : les articles retentissants de Lincoln Steffens, publiés en volume en 1904 dans The Shame of the Cities, l’avaient précédée d’une quarantaine d’années. Mais, Sutherland a engagé l’attention sur ce problème apparu au fil du xixe siècle et devenu au fil du xxe un problème central, non que les entrepreneurs soient désormais malhonnêtes, mais que la malhonnêteté soit devenue leur mode presque exclusif de gouvernance.
Ainsi, peu à peu au cours du xixe siècle, on est passé du modèle d’un Jean-Baptiste André Godin à celui d’un John Davison Rockefeller, l’un des plus célèbres « barons voleurs » du xixe siècle, puis au modèle Enron (Jeffrey Skilling), Metaleurop (Marc Rich) ou subprimes (Dick Fuld) sans oublier celui du patronat allemand sous le régime nazi.
Si le plus souvent est incriminé le capitalisme comme raison du White collar crime, il ne fait guère de doute que l’absence de figures d’autorité dans les démocraties modernes y contribue grandement : John Law n’est pas Dick Fuld, le souci du bien commun chez le premier est absent chez le second, et surtout Adam Smith fait du devoir de justice et de protection avec l’obligation du contrôle bancaire le premier devoir du souverain.
Enfin, le crime consuétudinaire inclut le crime politique qui n’est certes pas nouveau, mais dont la forme l’est comme le montre son étrange collusion avec le crime organisé et les élites économiques, collusion qui s’est développée dans tous les pays occidentaux depuis la fin du xixe siècle : la mafia naît vers 1850 et arrive aux États-Unis vers 1880 à La Nouvelle-Orléans, et de récents procès en France exemplifient cette collusion.
Le mal radical n’a donc point sa source dans l’irrationalité des passions, mais dans la genèse des maximes de l’action : « Le fondement du mal, écrit Kant, ne saurait se trouver dans un objet déterminant l’arbitre par inclination, dans un penchant naturel, mais seulement dans une règle que l’arbitre se forge lui-même pour l’usage de sa liberté, c’est-à-dire dans une maxime. Cependant au sujet de celle-ci, il ne faut pas aller plus loin et demander quel est le fondement subjectif en vertu duquel l’homme l’adopte intérieurement plutôt que la maxime opposée… Cela signifie seulement qu’il a en lui un principe premier [inscrutable, unerforschbar, pour nous] lui permettant d’admettre de bonnes ou de mauvaises maximes
Or, le défi de cette inscrutabilité se lève dès que nous reprenons la question de l’épigenèse du transcendantal telle que Freud l’aborde.
Si l’implémentation de l’idée régulatrice du juste suppose des conditions épigénétiques, son défaut peut être pallié par des figures d’autorité, ce que les Romains, l’Église, Machiavel et enfin Freud puis Lacan ont très bien saisi.
Trump serait-il la créature impensée d’Occam ?